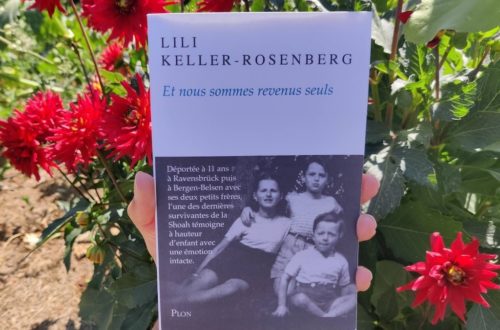Livre « Les victorieuses » de Laetitia Colombani
« Les victorieuses » est le premier livre de Laetitia Colombani que j’ai eu l’occasion de lire. Je l’ai connu par hasard, de part les thématiques qui en sont ressorties lors de mes recherches sur le site du réseau de médiathèques.
Solène a une belle carrière d’avocate pour laquelle elle a beaucoup sacrifié. Mais un jour c’est le burn-out, la dépression. Celle-ci va lui donner l’opportunité, suite au conseil de son médecin, de s’engager dans du bénévolat. Au début peu convaincue, elle va ensuite donner de son temps, se consacrer aux autres, à celles qui sont dans le besoin, en intégrant un foyer pour femmes en difficulté. Une expérience qui va bouleverser son existence et ses valeurs ! Des personnalités venues du monde entier qu’elle apprendra à connaître, malgré des échecs et des déceptions. Il y aura des drames, de la force, du courage et de la solidarité.
En parallèle, on découvre l’histoire de Blanche Peyron, officière à l’Armée du Salut. Elle a consacré sa vie à aider les plus démunis et a fondé le « Palais de la Femme » à Paris en 1926. C’est là où se passe l’histoire. Aujourd’hui, ce palais social accueille cinq dispositifs permanents d’hébergement ou de logement accompagné. Un bel hommage rendu par l’auteur à cette femme et son époux, un couple déterminé et engagé.
Ayant apprécié la lecture fluide et agréable, j’ai vite enchaîné avec le roman, « La tresse ». J’avais déjà eu l’occasion de vous en parler dans un précédent article, n’hésitez pas à le relire. 😉
Extraits du livre
« Il faut sortir de chez soi, se tourner vers les autres, retrouver une raison de se lever le matin. Se sentir utile à quelque chose ou à quelqu’un. »
« Du temps, voilà ce que demandent les associations. Sans doute ce qu’il y a de plus difficile à donner dans une société où chaque seconde est comptée. Offrir son temps, c’est s’engager vraiment. »
« Sa vie ressemble à une maison témoin que l’on fait visiter. La photo est jolie, mais il manque l’essentiel. Elle n’est pas habitée. Lui revient cette citation de Marilyn Monroe qui l’avait marquée : Une carrière c’est bien, mais ce n’est pas ce qui vous tient aux pieds la nuit. »
« Avec le temps va, tout s’en va, dit la chanson. Tout s’en va, sauf ça. Il est des deuils qu’on ne fait pas. »
« La plupart de celles qui vivent ici n’ont qu’un rêve : avoir leur propre logement. Habiter en foyer n’est pas un choix, mais une nécessité. Un pis-aller. Une salle d’attente pour une vie meilleure. L’attente peut durer longtemps, parfois des années. »
« Un jour, elle se tirera d’ici, dit-elle. (…) tout lui pèse, la promiscuité, le manque de liberté, le règlement intérieur qui fixe les horaires des visites, le surveillant qui la sanctionne au moindre pas de travers. Ici rien ne va. »
« Ils ne changeront peut-être pas (…) la vie de ces femmes, mais ils apporteront leur modeste contribution, comme le colibri de la fable de Pierre Rabhi, que Salma lui a racontée. Lors d’un terrible incendie de forêt, les animaux assistaient impuissants à la catastrophe. Seul un petit colibri s’activait, remplissant son bec d’eau pour jeter des gouttes sur les flammes. Pauvre fou, lui dit le tatou, ce n’est pas avec ça que tu éteindras le feu. Je sais, répondit le colibri. Mais au moins, j’aurai fait ma part. »
« Solène s’est accoutumée à ces femmes, à leurs manières un peu brusques, à leurs silences, à leur façon de dire merci. Les mots, elles ne les ont pas toujours, mais il y a un regard, un sourire, une tasse de thé, un tee-shirt donné. Parfois il n’y a rien du tout, et c’est sans importance. De la gratitude, Solène n’en attend pas. Elle n’est pas venue pour ça. Léonard lui a confié qu’en dix ans de mission, il a recueilli trois merci. C’est peu au regard des centaines de lettres qu’il a rédigées. Qu’importe. Il se sent utile, et cela n’a pas de prix. »
« Tous les deux ou trois jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint, dans ce pays qu’on dit civilisé. Jusqu’à quand ? Dans la nature, aucune espèce ne se livre à ce jeu de massacre. La maltraitance des femelles n’existe pas. Pourquoi, chez les humains, ce besoin de détruire, de briser ? Il y a les enfants, aussi. D’eux, on ne parle pas, ou si peu. Victimes collatérales des violences conjugales, ils sont des dizaines à mourir chaque année en même temps que leur mère, assassinés par leur père. »
« Sur l’échelle de la désespérance, elle descend tout en bas. Lorsqu’on touche le fond, dit-elle, on ne peut que remonter. Sa rencontre avec une assistante sociale va tout changer. A trente ans, Iris s’est enfin trouvée. Ici, elle se reconstruit. Elle commence seulement à penser qu’elle peut-être un avenir, que la vie lui réserve autre chose que la souffrance et le rejet. »
« Là, sous des monticules de vêtements aux couleurs démodées, de vieux agendas que l’on conserve sans savoir pourquoi, de vinyles, de cassettes VHS empruntées et jamais rendues, de boîtes à chaussures remplies de courrier et de tickets de cinéma – ah, cette habitude de ne rien jeter, comme si l’on conservait par le truchement de souvenirs futiles un peu de sa jeunesse envolée – (…)
« Dans la rue, tout est différent. Ce qu’elle ose entre les murs rassurants du Palais, Solène ne l’ose pas ici, devant la boulangerie. Aborder la jeune sans-abri, cela veut dire créer un lien, ouvrir la voie de l’empathie. Engager la discussion, c’est reconnaître l’autre dans son humanité. Difficile ensuite de le contourner, de continuer à l’ignorer. »
« De l’ouverture à la fermeture de la boulangerie, elle se tient là, à genoux, sur le pavé. A genoux, comme un pénitent. Comme un condamné.
Une femme à genoux dans la rue, cela devrait choquer le monde entier. Cela n’émeut personne, ou si peu. Cette image la hante, (…) »
« Il ne faut pas sous-estimer les petits gestes et les sourires, ils sont puissants. Ils sont autant de remparts contre la solitude et l’abattement. »
« Elle a passé quinze ans sur le pavé. Quinze ans sans toit, sans foyer. Quinze ans sans dormir dans un lit. Depuis, la Renée n’y arrive plus. Pas moyen de trouver le sommeil dans sa chambre, elle s’y sent enfermée. Elle préfère dormir dans les parties communes, entourée de ses cabas. Ses affaires, elle ne peut se résoudre à les ranger dans les placards. Elle a l’impression qu’on va les lui voler. Elle a besoin de les sentir autour d’elle, constamment, comme si toute sa vie tenait là, dans ces grands sacs qu’elle trimballe jour et nuit sur son dos, telle une femme-escargot. »
« Quinze ans de rue, c’est comme quinze ans de coma, dit la Renée. Lorsqu’on en sort, il faut se réadapter, retrouver chaque geste du quotidien ? Cuisiner, dormir dans un lit, faire la vaisselle, changer les draps, autant de défis pour une ancienne sans-abri. Ces mille petits rien qui font la vie, elle les avait perdus, laissés sur le pavé. Salma et les employés du Palais l’ont accompagnée dans ce long réapprentissage en forme de rééducation, tel un accidenté de la route ou un grand brûlé. »
« Les médias l’évoquent rarement, le viol des femmes sans-abri n’est pas un sujet présentable. Pas assez chic pour passer au journal de 20 heures, lorsque la France est à table. Les gens n’ont pas envie de savoir ce qui se passe en bas de chez eux lorsqu’ils ont fini de dîner et vont se coucher. Ils préfèrent fermer les yeux. Dormir, rêver. Un luxe que les femmes sans-abri ne peuvent s’octroyer. Dehors, elles sont autant de proies. La misère n’oppose pas de limite à l’horreur. »
« C’est une spirale sans fin qui chaque nuit recommence. Un voyage sans destination. Un départ sans arrivée. »
« Pour éviter d’être agressée, la Renée a coupé ses cheveux, dissimulé les signes de sa féminité. C’est ainsi, dit-elle, dans la rue, les femmes doivent se cacher pour survivre. Un cercle infernal et vicieux : en devenant invisibles, elles s’effacent, disparaissent de la société. Elles sont des Intouchables, des fantômes errant à la périphérie de l’humanité. »
« Bien sûr, le combat n’est pas terminé, il reste du chemin à parcourir, mais la Renée est là, en vie. Elle a un toit. Plus personne ne l’éveille la nuit à coups de pied pour la violer. Entre les murs du Palais, elle tente de retrouver sa dignité, qu’elle a laissée sur un banc, il y a longtemps. L’estime de soi, c’est ce qu’il y a de plus difficile à regagner.«
En attendant, elle garde la tête haute. La tête haute, toujours. Telle est la devise de la Renée. »
« Les obstacles ne sont que des cailloux sur la route, lui dit-il. Le doute fait partie du chemin. Le sentier n’est pas uniforme, il y a des passages agréables, des tournants raboteux et pleins d’épines, du sable, des rochers, avant les prairies couvertes de fleurs… Il faut continuer d’avancer, quoi qu’il en coûte. »
« Solène est muette. Cette disparition la foudroie. La mort de Cynthia, c’est l’échec de toute la société. Celui du Palais, de l’Aide à l’enfance. Celui des foyers d’accueil et des éducateurs, de tous ceux que la jeune femme a croisés au cours de sa brève existence. Malgré les efforts des uns et des autres, personnes n’a su l’aider, la tirer des sables mouvants dans lesquels elle s’enfonçait, lentement. »
« Elle n’est pas taillée pour ce genre de combat. Elle ne sait que faire du chagrin de ces femmes, de leurs vies abîmées qui viennent se cogner à la sienne, l’ébrécher encore davantage.
Elle a tenté de se protéger, de suivre les conseils de Léonard. La distance, avait-il dit, c’est le maître mot. On ne peut pas endosser les drames de tous ceux qui viennent se confier. Il faut savoir se préserver. Enfiler une carapace en entrant au Palais, et l’enlever en sortant, Solène en est incapable. Elle n’a pas l’âme d’une tortue ou d’un crustacé. Sa cuirasse prend l’eau, elle fuit de tous côtés. »
« Il confie qu’il a pris l’eau, lui aussi, il y a quelques années, lorsque son ex-compagne l’a quitté. Elle était maman de deux jeunes enfants quand ils se sont rencontrés. Ces petits, Léonard les a aimés, bercés et élevés comme les siens. Il a vécu dix ans de bonheur à leurs côtés, avant qu’ils ne lui soient arrachés. C’est un fait, la société ne prévoit rien pour les beaux-pères et belles-mères abandonnés. Ni droit de garde, ni visite. Sans lien de parenté avec l’enfant, on n’a pas de statut. On n’existe plus. On disparaît, on s’efface de leur histoire comme une silhouette qui s’évanouit sur une photo ancienne, comme un visage dont on ne parvient pas à retenir les traits. (…) Dans la séparation, il n’a pas seulement perdu une compagne, mais une famille. Il s’est retrouvé orphelin. De son ancienne vie, il ne lui reste rien, sauf les quelques dessins que les enfants lui ont laissés. Dix ans réduits à trois bouts de papier. »
« Elle n’est peut-être qu’un colibri, mais ses ailes sont immenses. »